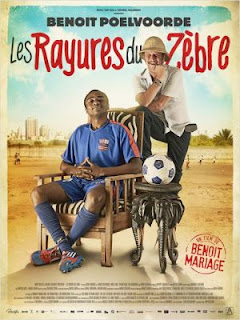J'avais
le temps. Mais, en fait, le temps finit toujours par manquer. Alors
que notre envie d'en disposer et de le rendre éternel demeure.
(Rodrigo
Fresán, La passion des foules, in Histoire argentine,
trad. Isabelle Gugnon, Seuil, 2012)
Pour
finir en beauté le mois de février 2014, quelques citations que
j'ai tirées de mes lectures ce mois-ci, extrêmement éclectiques.
Des phrases à méditer !
Sur
le genre (dont on parle tant) :
"Masculin
et féminin ne sont-ils pas extrêmement mêlés dans l'être humain!
Et ainsi tu comprends que dans une réflexion sur la culture j'estime
un peu primaire la typologie "homme", "femme".
Pourquoi en rester si souvent à cette distinction (comme principe
conceptuel ? Bien !). Mais si l'on vise le concret, l'atomisation
doit aller beaucoup plus loin, jusqu'à l'individualité la plus
singulière. L'Europe est faite d'individus (comportant chacun du
masculin et du féminin), non pas d'hommes et de femmes."
(Walter Benjamin, Lettre à Herbert Belmore, 23 juin 1913)
Sur
les hommes politiques de tous les temps :
Années 1900 : Louise
Michel : "Les
uns sont conservateurs, les autres républicains, libres-penseurs ou
socialistes, ça ne fait rien, pourvu qu'on arrive."
(conversation rapportée par Ernest Girault, Une
colonie d'enfer, Ed.
Libertaires, 2007) ;
Années 1980 : "Ces
gens [Marchais, Chirac] mentent. Ils sont eux-mêmes harassés par
leur lutte pour la popularité, mais en vain, car ils sont à
eux-mêmes leur propre déveine, curieusement parallèles, haineux
tous deux sans répit aucun, inlassablement plantés au milieu du
décor. Tragiques : des appariteurs du musée du pouvoir."
(Marguerite Duras, Je ne
crois pas au mot gloire...,
1986, in Le monde
extérieur : outside 2,
POL, 1993) ;
Années 1990 : "La
décennie 1990 avait désormais poussé la politique vers une voie de
garage, vers la compétition entre nullités. En cette époque qui
fait de la conquête du centre le seul credo stratégique, la
grisaille et la sottise deviennent valeur ajoutée."
(Paolo Persichetti, Exil
et châtiment : coulisses d'une extradition,
Textuel, 2005)
Sur
l'écriture :
"En
général, un écrivain ne sert à rien et n'a d'utilité que pour
lui-même. Certes, il y a aussi les lecteurs, qui constituent un
monstre tout aussi mystérieux et respectable. Mais qu'est-ce qui
pousse quelqu'un à s'asseoir pour écrire alors qu'il pourrait faire
un tas d'autres choses bien plus gratifiantes à court et moyen
terme ? C'est choisir une vie bien pénible […] que
d'affronter chaque jour une feuille blanche, chercher quelque chose
dans les nuages pour le ramener sur terre. Une page blanche, c'est
presque aussi intimidant qu'une arme à feu braquée sur un visage."
(Rodrigo Fresán,
La vocation littéraire,
in Histoire argentine,
trad. Isabelle Gugnon, Seuil, 2012) ;
"Lire
et surtout écrire, c'est me découvrir unique, intense et fertile
devant l'instant présent qui passe, tout en relativisant la
fragilité humaine qui m'habite, en la déléguant ailleurs
momentanément, tout en l'extraterritorialisant quelque peu loin de
moi. Opération magique pour laquelle je n'ai besoin que de papier."
(Antoine Vivaud, Senesco,
1987-2004 : journal d'un vieillissement,
Fayard, 2006)
Sur
la modernité :
"Il
se rappelait combien ces femmes avaient été contrariées lorsque
l'électricité était arrivée dans leur petit coin de pays. Mais ce
n'était pas tellement l'électricité qui les dérangeait, plutôt
les réverbères. À quoi bon détruire la nuit ?"
(Nii Ayikwei Parkes, Notre
quelque part, trad. Sika
Fakambi, Zulma, 2014) ;
"Aussi
le Faust d'aujourd'hui ne cherche-t-il ni connaissance, ni amour,
mais célébrité, succès populaire, son nom en haut de l'affiche.
[…] Tu veux vendre des millions d'exemplaires de ton livre ?
Marché conclu : tu auras des piles de tes œuvres à la FNAC
[…] on t'achètera les droits pour faire un film avec Tom Cruise
[…] Et pour obtenir tout cela, tu n'auras quasiment rien à perdre,
sauf la qualité artistique, le style, la grammaire, l'invention
narrative, la responsabilité morale, la position éthique, la
reconnaissance des futurs lecteurs, le respect de tes contemporains :
ton âme."
(Alberto Manguel, Monsieur
Bovary & autres personnages,
L'Escampette, 2013)
Sur
le métier d'enseignant :
"Il
s'interrogeait sur le but de son travail. Que faisait-il dans un
endroit où le titre de professeur était si dévalorisé ? Quel
était son rôle, si toutefois il en avait un, alors qu'il récitait
des litanies sur les droits de l'homme en constante contradiction
avec les nouvelles parues dans les journaux, ou qu'il parlait du
droit des peuples à une autodétermination dont les pays riches se
foutaient comme de leur premier bonnet phrygien ? "
(Rolo Diez, In
domino veritas, tard.
Alexandra Carrasco, Gallimard, 2003)
Sur
le fait de vieillir :
"J'attends
d'avoir soixante ans pour vraiment jouer les rôles de mon âge. À
ce moment-là il sera tout à fait impossible de tricher."
(Ingrid Bergman, conversation avec Marguerite Duras, Bergman
encore et toujours Bergman Bergman,
1966, in Le monde
extérieur : outside 2,
POL, 1993) ;
"Je
fourbirai les armes. L'ennemi veut ma mort que je ne crains pas. Les
chiffres sont des salauds. Ils comptent sur les faiblesses du corps,
vertiges, raideurs, etc... pour m'avoir à disposition. […] Mauvais
acteurs, les chiffres ! Je mourrai, d'accord, mais jamais je
n'accepterai d'être morte. Nuance. La tour de contrôle du grand
cirque, c'est moi qui la surveille." (Dominique Rolin, Le
futur immédiat,
Gallimard, 2002)
Sur
une certaine forme de cinéma contemporain (ça s'est encore aggravé depuis !) :
"est-ce
d'ailleurs encore du cinéma que ce futurisme répétitif qui
s'adresse à l'adolescence ?"
(Marguerite Duras, Pour
une nouvelle économie de la création,
1985, in Le monde
extérieur : outside 2,
POL, 1993)
Sur
l'ordre :
"Moi,
j'étais incapable de ranger. Il aurait d'abord fallu que je fasse le
ménage dans ma tête."
(Louis Atangana, Une
étoile dans le cœur,
Rouergue, 2013)
Sur
la vie, en général, les réflexions d'un prisonnier :
"3
mai 2006 : Discutant avec Toto sur les taules, lui comme moi
croyons avoir trouvé la clef pour survivre lorsque tout va mal. Il
faut regarder en bas. Dit autrement, il y a pire. Pire, c'est être
rejeté des siens. Pire, ce serait baigner dans la frayeur au point
de ne jamais remettre les pieds hors cellule, et ils sont nombreux
dans ce cas. Plus loin, ce serait d'être embastillé dans une prison
turque ou latino-américaine. Dehors, pour positiver, nous
regarderions vers le haut, vers un objectif. Conclusion, dans notre
non-monde, tout est inversé."
(Christophe de La Condamine, Journal
de taule, L'Harmattan,
2011)