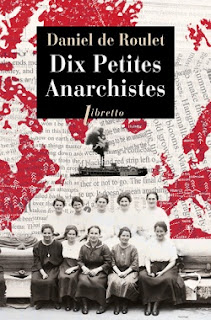Les
Indiens, mieux que tout autre peuple, les Arabes exceptés, entendent
les liens de l’hospitalité, cette vertu des nomades ignorée dans
les villes, où elle est, à la honte des peuples civilisés,
remplacée par un froid égoïsme et une méfiance honteuse.
(Gustave
Aimard, L’éclaireur,
in Les Trappeurs de l’Arkansas et autres romans de
l’ouest, Laffont, 2001)
Qui
a dit que les romanciers populaires du XIXe siècle véhiculaient un
racisme primaire, y compris Jules Verne ? En tout cas, Gustave
Aimard, connu pour ses nombreux westerns, échappe souvent à cette
règle ; dans un autre de ses livres, on trouve : "vous
seriez stupéfait de la finesse et de l'intelligence raffinée de ces
Indiens que vous nommez dédaigneusement des sauvages, parce qu'ils
ne veulent pas accepter votre civilisation et préfèrent la leur"
(Les
bandits de l'Arizona,
même
édition).
Je
pensais à lui en lisant Le
facteur humain,
de notre ami cycliste Vincent Berthelot et dans son livre, on trouve
les réflexions suivantes que n’aurait pas désavoué le bon
Gustave Aimard, trop peu réédité aujourd’hui : "Déjà
au XVIIIe siècle, les encyclopédistes Diderot et d’Alembert
observaient le déclin de l’hospitalisé en Europe « voyageante
et commerçante. […] L’esprit de commerce, en unifiant toutes les
nations, a rompu la chaîne de bienfaisance des particuliers ».
Aujourd’hui, nous continuons à transformer en or cette
hospitalité. Nous la monnayons auprès de nos hôtes de passage"
ou bien "Avec
la fin de la gratuité, c’est la fin du voyage. Avec la
monétisation de nos rencontres, nous cherchons la sécurité. Nous y
avons perdu et l’aventure et la rencontre".

Le
moment venu de la retraite, Vincent Berthelot, qui a
préparé
le terrain auparavant, se lance dans une folle équipée à vélo
couché a travers la France : "Je savais que je voyagerais.
Je savais que je le ferais à vélo par un effet cumulatif : un
intérêt pour mon bilan carbone, mon goût prononcé pour la
pratique de la bicyclette, une once de fainéantise m’orientant
horizontalement vers la route".
Je n’ai jamais fait de vélo
couché, mais j’ai fait de nombreuses randonnées cyclistes en
France (Aquitaine, Poitou, Alpes, Massif central, Bretagne,
Languedoc, Provence, Jura, Vosges, Pyrénées, Val de Loire,
Picardie, et même Guadeloupe), et je sais que c’est dur, même
quand on ne cherche pas l’exploit et
qu’on part plutôt léger (c’était mon cas).
Le
vélo couché de Vincent, avec tous ses accessoires, tente, duvet, un peu de
nourriture et de boisson, vêtements de rechange, et surtout le sac à
lettres, pèse aux alentours de quarante kilos !
Car
notre héros a un objectif précis : il
a demandé à ce qu’on lui donne des lettres à distribuer ici ou
là à des personnes qu’il connaît (parfois) ou pas (le plus
souvent), et qui seront bien étonnées de sa visite, programmée
certes par lui, mais inconnue des destinataires. Il sera le facteur
humain.
Et ce sera l’occasion de rencontres inoubliables : "Chaque
maison est un royaume où je suis accueilli comme un ambassadeur.
Chaque rencontre est une aventure. Chaque départ finit en
embrassades. La terre, cette hospitalière, est encore capable de
m’offrir mille et une fantaisies. Aucune ingénierie touristique ne
saurait imaginer de telles richesses".
Pourquoi
des lettres à l’époque du numérique ? Parce que les techniques
modernes de communication lui paraissent un média froid qui ne
remplace pas le contact ni l’humanité. Parlant d’une de ses
correspondantes, il dit : "Elle
souhaite donner à son courrier le poids et l’amour qu’il
convient. La messagerie électronique n’a pas cette qualité, le
téléphone non plus".
C’est
particulièrement vrai des personnes âgées, des esseulés, des amis
de jeunesse perdus de vue, pour qui une lettre apportée de la main à
la main, fait chaud au cœur, comme un rayon de soleil qui déchire
la brume du quotidien. Combien je vois encore des personnes âgées
de ma tour descendre à leur boîte aux lettres tous les jours, et
remonter le plus souvent à
leur appartement tristement
bredouilles,
et parfois le sourire aux lèvres, les yeux rayonnants, tenant à la
main tremblante une missive qu’ils ou elles vont longuement
considérer avant de se décider à l’ouvrir, avec une joie
impérieuse, puis de la ranger dans un tiroir ou une boîte, et la
relisant les jours suivants, étonnés de n’avoir pas été
complètement oubliés.
Vincent
Berthelot a
balisé
la France par les petites routes, propices à l’exercice du vélo :
"L’homme
de la capitale ignore superbement ces chemins. Il a construit son
pouvoir sur la compétition, la vitesse et la réussite individuelle.
Il ne réussit pas à changer ses références. Il se nourrit d’une
hypothétique croissance individuelle, à force de projets inutiles
et destructeurs. Sa moisson c’est l’exclusion de l’autre. La
violence protéiforme en est son corollaire immédiat". Et
surtout, à notre époque de vitesse effrénée, il apporte le
plaisir de la lenteur, de celui qui vient, à la fois chemineau et
météore nomade, porter au sédentaire un bonjour amical, venu de
loin, dans l’espace et le temps : "La
locomotion à l’aune des capacités de notre corps est un acte de
résistance. Le marcheur, le cycliste, le rameur pourquoi pas,
offrent une image à contre-emploi du modèle aujourd’hui dominant
dans notre société".
Chemin
faisant, il se livre à des soliloques sur le prétendu « progrès ».
Sur la peur qui semble désormais régner : "Selon
l’INSEE, seuls onze pour cent des enfants vont à l’école sans
être accompagné d’un adulte. La plupart de ces mêmes adultes
sont allés seuls à l’école à pied ou à vélo. Le monde
serait-il si dangereux qu’il faille aujourd’hui interdire
l’espace public aux enfants ?" [et les plaisirs de l'école buissonnière] ? On
l’interroge sur le fait de partir seul à l’aventure (j’ai subi
les mêmes remarques de mon entourage) :
"—
Tu n’as pas peur ? —
Peur de quoi ? —
Avec tout ce qu’on voit ? —
Qu’est-ce qu’on voit ? —
Ben, je sais pas." Cette
peur irrationnelle de ceux qui se sont volontairement privés
d’aventure, liée certes au mode de locomotion, mais
aussi à
"une
sorte de fantasme sur la dangerosité supposée de l’autre, de
l’étranger, de celui qu’on ne connaît pas". Alors
même que tout l’intérêt est là, dans la rencontre des êtres humains.
Il
est étonné au contraire par la richesse de ces rencontres, il croise
l’humanité dans toute sa splendeur : "La
rencontre est probablement le mystère et le trésor de cette
histoire. Ce n’est pas votre carte bancaire qui la permettra. c’est
le temps que vous y consacrerez. Privilège des retraités, des
malades, de quelques enfants pas encore empêchés, des SDF, c’est
une denrée chère sur le chemin, le temps partagé m’a rendu
chaque jour plus riche". Il
fustige ceux qui "nous
font préférer l’argent à l’échange, le statut à la personne,
la possession à la confiance, le pouvoir au service, l’esprit de
caste à l’humanité", et
trouve dans ses pérégrinations une simplicité de bon aloi, une
hospitalité extraordinaire, à faire pâlir ceux qui ne croient
plus en la solidarité.
"Quand j’observe sur moi-même l’effet positif des regards
bienveillants, je trouve dommageable ces vécus scolaires si
négatifs", que
malheureusement pèse sur nombre de nos concitoyens :
"Le regard de l’école a été vécu par beaucoup comme
disqualifiant, réprobateur quand ce n’est pas agressif et
humiliant". Et
il reproche à notre société la
"disqualification et la mise à l’écart des autres"
fondée
sur "sur
la sélection des meilleurs".
Rassure-toi
Vincent ! Tu as gardé ta liberté individuelle, ce qui ne t'empêche pas d'être ouvert aux autres. Tu as même
rencontré sur ta route un réalisateur de télévision suisse qui a
décidé de te suivre et de faire des
films
documentaires
de ton équipée :
https://www.youtube.com/watch?v=X72HGCTNTcI
et
https://www.youtube.com/watch?v=yJ741nxDtBg
Alexandre Dechavanne, cycliste lui-même et qui dit : "Souvent
des amis me demandent si je vais plus vite en vélo dans le centre
ville de Genève où j’habite, si je gagne
du temps. En réalité je gagne le droit d’aller lentement".
Et toi, Vincent, tu as gagné le droit de nous dire : "Devenir
messager s’est alors imposé comme la solution du contrat que je
m’étais donné. Chaque destinataire me donnerait un but,
l’ensemble de ces destinations me donnerait ma route".
Et
c’est la route d’un grand bonheur pour le lecteur qui te suit, Vincent ! Et, pour les lecteurs de mon blog, excusez la redondance, puisque j'avais déjà évoqué assez abondamment ce livre le 2 septembre dernier dans mon "post" Voitures et/ou vélos.