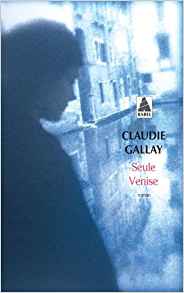chaque chose que vous apprenez doit se rattacher à quelque chose que vous savez déjà. C'est ainsi que le savoir se construit.
(Claudie Gallay, Seule Venise)
J'aurais bien eu envie encore de parler une fois de plus d'amour, surtout après avoir vu le film de Christophe Honoré, Les bien aimés, qu'on pourrait titrer plus justement "Les mal aimant", et dont la phrase que dit Madeleine (Catherine Deneuve, vieillissante et pathétique) à sa fille (Chiara Mastroianni) reflète assez bien la philosophie : "C'est très dur de dire à quelqu'un : je t'aime, en pensant : je ne t'aime pas". Mais chaque chose en son temps, ça reviendra.
Demain, je pars à Venise pour dix jours. Pour m'y préparer, je suis allé au cinéma voir un autre film d'amour, Impardonnables, le film de Téchiné, avec André Dussolier (assez attristant lui aussi) et Carole Bouquet, et qui se passe à Venise, j'ai revu en DVD Mort à Venise, de Visconti, que je n'avais pas vu depuis 1971, et j'ai lu le très joli roman de Claudie Gallay : Seule Venise. Dans ce dernier livre, extrêmement sentimental (mais au bon sens du terme), j'ai relevé plusieurs phrases, dont celle-ci : "Dans les camps c'était l'horreur, mais ça je le savais. Ce que je ne savais pas, c'est que des hommes qui ont été enfermés là-bas ont été sauvés de la mort parce qu'ils se récitaient des poèmes. Des poèmes, mais aussi des livres... Ils retrouvaient les mots, les moindres détails. Ils parvenaient à cela. Ils avaient cette force. Et ça les a empêché de mourir".
Et pour ponctuer ces belles phrases (tout en sachant que mes propres poèmes n'ont peut-être pas le même pouvoir), comme le mois d'août s'achève, voici mon poème sur mon prochain grand voyage en cargo, qui devrait débuter le 10 janvier, pour un tour su monde, de Tanger à Tanger, en passant par Suez, l'Arabie, l'Océan indien, Singapour, la Chine, la Corée, l'Océan Pacifique, Panama, les États-Unis et l'Océan atlantique. Voilà, ça m'a inspiré !
Le jour où je ferai un long voyage sur un navire
comme un passeur de rêves je dégusterai la lenteur des crépuscules
j'ouvrirai le cercle de ma pensée
pour saluer le silence
ou plutôt pour mêler le son des vagues à la lumière du soir
Ah ! Être au cœur des choses
être debout dans la mer
dans la mer infinie sous les racines du ciel
dans la mer, vaste plaine insomniaque
qui palpite toujours, même la nuit
Et peut-être que je retrouverai
comme un écho des temps passés
Robinson, Moby Dick, l'île au trésor
et je franchirai la passe où se cache Nemo
et je passerai des heures avec Ulysse chez Calypso
Oui, je découvrirai l'espace presque infini
l'espace rond, transitoire et sans bornes
et les nuits magnétiques et les jours innombrables
et le calme plat et les tempêtes
et au milieu de l'Océan
Surtout, surtout,
je mettrai la poésie sur le gril !