le
lit et la solitude sont les pires refuges pour qui souffre dans
l'âme.
(Camilo
Castelo Branco, Mystères de Lisbonne)
"En
somme, trois choses demeurent : la foi, l'espérance et l'amour, mais
la plus grande d'entre elles, c'est l'amour",
trouve-t-on dans la première
épître de Paul aux Corinthiens (13,
13), où il énonce ce que l'on a appelé ensuite les trois vertus
théologales. Sans doute, est-ce par allusion à ce verset que le
cinéaste autrichien Ulrich Seidl vient d'entamer une trilogie de
films, dont le premier s'intitule Paradis :
Amour.
Les deux autres devront « traiter » de la foi et de
l'espérance. Le premier volet est un film très dur, désespéré,
désespérant, comme souvent les films autrichiens (voir ceux de
Haneke : Funny
games,
La
pianiste,
Le
ruban blanc)
ou la littérature de ce pays (lire Thomas Bernhard, Peter Handke,
Ingeborg Bachman, Elfriede Jelinek). Les écrivains et cinéastes y
décrivent un pays où la dénazification n'a pas eu lieu (mais la
dépétainisation en France a-t-elle eu lieu ? La manifestation
des réacs aujourd'hui même semble bien montrer que non !), où on
est noyé dans le confort matériel, mais dont l'âme paraît
absente, comme pour corroborer les propos de Nietzsche : "Est-il
encore un haut et un bas ? N'errons-nous pas comme à travers un
néant infini ? Ne sentons-nous pas le souffle du vide ? Ne
fait-il pas plus froid" (Le
gai savoir) ?
Oui,
on frissonne en voyant ce film (malgré la chaleur des tropiques et
la beauté des plages), dans lequel des femmes mûrissantes et
rondelettes, sevrées d'amour chez elles (les hommes ne les regardent
plus, ne les touchent plus), partent en vacances au Kénya et
trouvent chez les jeunes noirs un exutoire à leur mal-être. Misère
sexuelle d'un côté, misère tout court de l'autre, les unes
achètent un semblant d'amour, les autres vendent leur corps dans une
démonstration assez efficace de ce que Viviane Forrester a appelé
il y a quelques années l'horreur
économique.
Les rires de ces femmes esseulées, "qui
ne font plus l'amour mais y pensent sans cesse"
(Grégoire
Delacourt, L'écrivain
de la famille),
nous font mal au cœur. C'est qu'on est ici dans cette nouvelle forme
de néo-colonialisme que constitue le tourisme sexuel, qui ne semble
plus réservé seulement aux hommes, si j'en juge par ce film, qui
avait été précédé sur le même sujet en 2005 par celui de
Laurent Cantet, Vers
le sud,
d'après des nouvelles du Haïtien Dany Laferrière.
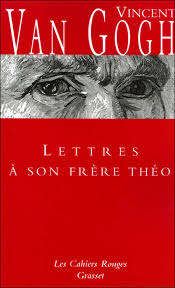
On
est très loin de Van Gogh : "Si
l'on continue à aimer sincèrement ce qui est vraiment digne
d'amour, et qu'on ne gaspille pas son amour à des choses
insignifiantes et nulles et fades, on obtiendra peu à peu plus de
lumière et on deviendra plus fort"
(Lettre
à son frère Théo,
3 avril 1878). Le leurre du tourisme sexuel (un semblant d'amour),
l'échange inégal qui culmine dans la scène assez terrible de
l'adolescent « offert » à Térésa par ses amies pour
son anniversaire, font mieux comprendre à quel point "la
joie, comme l'amour, est à la mesure de ce qu'on y met"
(Mathieu
Terence, Petit
éloge de la joie).
Finalement, tout cela est pitoyable : peut-être les hommes
(mâles) trouvent-ils leur compte dans ce genre d'affaire. Je doute
fort que les femmes – même en admettant aujourd'hui qu'à force de
revendiquer l'égalité, elles en arrivent à essayer de singer les
côtés déplaisants du masculin : l'amour sans amour, en
l'occurrence – y trouvent leur compte. Le film montre bien leur
tristesse profonde, on dirait des zombies à la recherche de quoi ?
Comme l'écrivait Serge
Sur dans Plaisirs
du cinéma,
à propos du film de Bunuel L'ange
exterminateur,
"Tous
les protagonistes [...] ont choisi le corps contre l'âme, et ils ne
se consolent pas de n'avoir plus d'âme".
Revenons
à Van Gogh ; il écrit à Théo en avril 1882 : "Que
suis-je aux yeux de la plupart – une nullité ou un homme
excentrique et désagréable – quelqu'un qui n'a pas de situation
dans la société ou qui n'en aura pas, enfin un peu moins que rien.
Bon, suppose qu'il en soit exactement ainsi, alors je voudrais
montrer par mon œuvre ce qu'il y a dans le cœur d'un tel
excentrique, d'une telle nullité".
Ces femmes qui vont au Kenya rechercher un semblant d'amour, parce
que les hommes de leur pays les considèrent comme des nullités
moches et jetables, des moins que rien désagréables parce qu'elle
ne sont plus sortables dans nos sociétés du paraître, ces femmes
auraient bien besoin pour dépasser ce mal-être, typique de notre
monde du confort, de montrer ce qu'elles ont dans leur cœur, dans
leur âme. Et là – c'est peut-être le tragique de ce film – on
a l'impression d'un vide sidéral ! On
peut penser donc que le titre du film est une antiphrase, car il
aurait tout aussi bien pu s'appeler Enfer :
absence d'amour.
Et on imagine bien que les deux autres volets du triptyque seront
aussi consacrés à l'absence de foi et à l'absence d'espérance qui
sont caractéristiques de notre époque.
J'espère me tromper...

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire