Et pour vous rassurer, vous diriez ce que tout homme bien portant dit des lieux où l‘on souffre : ce n‘est pas si terrible qu‘on le dit.
(Marcelle Sauvageot, Laissez-moi (Commentaire) )
C’est curieux comme souvent les lectures, les films, les faits que l’on côtoie dans la vie courante, ce que l’on entend à la radio, les amis que l'on se fait, tissent des liens très étroits avec notre être profond, ce qui me laisse à penser qu’il n’y a pas tant de hasard que ça, que souvent nous tenons entre nos mains la flamme vive de notre unité. Mais ce qui, en plus de l'amitié, rend la vie plus belle, qui nous identifie (j’ai été très content d’entendre un lecteur de mon nouveau livre D’un livre l’autre me dire : «on en apprend plus sur toi dans ce livre que par le précédent», alors que pourtant je parle des écrivains et peu de moi), qui, comme une traînée d’or, nous porte dans les feux du soleil, c’est bien assurément les bons livres.
J’ai lu ces temps-ci deux livres exceptionnels, celui de Marcelle Sauvageot cité en exergue et celui de Robert McLian Wilson, La douleur de Manfred. Tous deux traitent de la douleur de vivre. Dans les deux cas, le personnage principal, la narratrice (l’auteur ?) dans Laissez-moi et le dénommé Manfred, sont gravement malades et en fin de vie, le monde pour eux devient ténèbres.
On pourrait croire qu’en ce moment j’ai plutôt envie de me lancer dans des lectures d’œuvres joyeuses, roboratives, qui me feraient oublier ce que j’ai vécu ces dernières années. Diable, l’oubli se fera tout seul ! D’ailleurs, j’ai toujours été d’un tempérament heureux, et ma capacité d’oubli est incroyable : j’oblitère presque tout de suite les événements tragiques qui me traversent. Sans doute reviennent-ils parfois au galop dans des cauchemars ou même dans des éclairs fugitifs diurnes, mais dans l’ensemble, j’ai toujours pratiqué la résilience sans le savoir, sans connaître même ce mot.
Cependant, j’ai besoin de comprendre aussi, besoin de me comprendre, de savoir comment vivre, comment survivre, et même savoir qui je suis. Ce qui peut paraître étonnant à soixante ans passés : je crois pourtant que le questionnement de Socrate, connais-toi toi-même, dure toute la vie, et qu‘on n‘a pas trop d‘années pour y parvenir. Et là, pas de doute, la littérature peut nous apporter des éléments de réponse, mais pas si elle est lénifiante, ou simplement chargée de divertir (songeons à ces «livres charmants, sans prolongement aucun, sans nuit. Sans silence», dont parlait Marguerite Duras).
J’en reviens toujours à mes interrogations de jeune bibliothécaire, qui me turlupinaient pendant les années 70 : quels livres pour quelle bibliothèque ? Doit-on se contenter d’aligner des best-sellers et de la littérature pré-digérée, ce que demande - hélas - tout un public petit-bourgeois (puisque nous n‘avons pas réussi à attirer le public issu des couches populaires), ou la bibliothèque publique doit-elle avoir une dimension humaine, sociale, éducative, pluraliste, qui permette à des gens comme moi, qui avais peu de livres à la maison, de découvrir les grands écrivains, les seuls à apporter une réponse aux grandes questions de notre existence ? Oui, j’étais reconnaissant aux bibliothèques (et, je l’avoue, à mes amis lecteurs aussi, qui d‘ailleurs continuent à m‘alimenter en nouvelles découvertes) de m’avoir fait connaître Dostoïevski, Kafka, Tchékhov, Kawabata, Shakespeare, Hamsun, Kazantzakis, Goethe parmi bien d’autres phares littéraires, puisqu‘on n‘étudiait que la littérature française au lycée. Peut-on s’en passer ? Il faut croire que oui, puisqu’on ne trouve pas de tels auteurs dans bon nombre de bibliothèques. Refermons la parenthèse, qui pourrait faire l’objet d’un livre entier !

Nos deux héros sont donc en fin de vie, et bien entendu, ils s’interrogent sur la maladie et sur la mort. «Qui sait, il y avait peut-être une trêve avec la maladie ! Elle doit bien de temps en temps se reposer, avoir des dimanches et des jours de fête… Ces jours-là, il doit être possible de vivre comme autrefois», lis-je dans Laissez-moi. La narratrice essaie de comprendre la lettre de rupture de son amoureux, alors qu’elle aurait tant besoin d’être accompagnée par lui jusqu’à la mort. Mais finalement, elle ne lui en veut pas vraiment, elle comprend qu’il n’est qu’un homme, faible, préférant une compagne en meilleur état : «Et pour vous rassurer, vous diriez ce que tout homme bien portant dit des lieux où l‘on souffre : ce n‘est pas si terrible qu‘on le dit.» Oui, en lisant cette phrase, je repensais à Ruth Klüger, et à la difficulté de parler d’Auschwitz : puisqu’on en est revenu, c’est que ça ne devait pas être si terrible, pensaient certains…
Pour Manfred qui, lui, a justement épousé une survivante des camps de la mort, la douleur est une permanence. D’abord, il est juif, et dans l’Angleterre hyper hiérarchisée et raciste (lire attentivement ce savoureux dialogue avec son voisin, l’infirmier noir ; «Saviez-vous que j‘étais juif ?» demanda [Manfred]. Le sourire de Garth grandit jusqu‘à occuper tout son visage. «Saviez-vous que j‘étais noir ?»), il était plutôt au bas de l’échelle. Il a fait la guerre dans l’armée anglaise comme une sorte de zombie, tout étonné de sortir vivant de ce monceau de cadavres : «Les survivants bambochaient et chantaient pour ne rien entendre. La fête était un analgésique, une narcose coupable. L’univers était devenu un ossuaire, un charnier. Nul drapeau, nul idéal de vainqueur ne pouvait être brandi sans tache.» Les débuts de son mariage sont heureux, mais, après la naissance de son fils Martin, il est rongé par les silences d’Emma, et ses démons intérieurs le corrodent : un beau jour, il commence à battre sa femme, qui reste silencieuse, puis continue, de plus en plus sauvagement. Jusqu’au jour où celle-ci, lassée d’être battue, le chasse. Et commence alors pour lui une descente aux enfers, dans une solitude de plus en plus complète, que la maladie contribue à accroître : «Mais il appréhendait la solitude de son appartement - inutile de presser le pas pour retrouver ce lieu désert. Il n‘y avait personne pour remplir les endroits vides de son logement.». Sans parler de la vieillesse, qui concourt à l’isolement. Manfred fait sienne les paroles d’un vieillard qu’il a rencontré : «Vous autres, les jeunes gens, vous êtes pour moi des fantômes, des rêves. Votre monde est irréel. La plupart des gens avec qui j’ai autrefois partagé le monde sont morts. Vous me croyez solitaire et presque défunt. Mais pour moi, c’est vous qui existez à peine.»
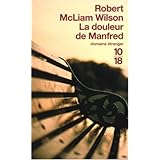
Et je retrouve ici un écho de Marcelle Sauvageot :«Ce temps du passé, quand résonne encore si proche le présent, est triste comme les fins de fête, lorsque les lampes s’éteignent et qu’on reste seul à regarder partir les couples dans les rues sombres.» Oui, quand on cumule tant de discriminations (la judéité pour Manfred, qui pense comme Sartre : «comme toujours lorsqu‘il rencontrait quelque manifestation antisémite, Manfred se sentait soudain un peu plus juif que d‘habitude», la maladie, tuberculose pour Marcelle, cancer pour Manfred, l’abandon par rupture du lien amoureux pour tous les deux, le vieillissement pour Manfred, et l’approche de la mort pour tous les deux), on vit dans un temps différent du temps ordinaire. Et ce que dit McLiam Wilson de Manfred : «Il ne désirait pas vraiment la mort, mais il mourait d’envie d’être débarrassé de la vie», s‘applique aussi à l‘autre livre. Et s’appliquait pour Claire pendant ses derniers mois.
Voilà pourquoi ces livres sont importants, pour moi du moins, et m‘ont permis de mettre des mots sur mon vécu. Ils contribuent, comme tout grand livre, à ne pas dévaluer «l‘étoffe précieuse du temps» dont parle notre auteur. Dans la lueur de la nuit, figée de fatigue comme une bête de somme, quand j’ai ouvert les volets vers sept heures ce matin, j'ai vu la neige tourbillonner, et je sentais davantage d’harmonie en moi grâce à ces lectures, mon âme était moins mélancolique. Et c’est vraiment là la victoire de la littérature, qui nous est à la fois nourriture, vêtement, maison, air pur, espace, reflet de nous-mêmes, puisque nous intégrons, ingérons, assimilons ce que d’autres ont écrit, danse et parfum de l’âme. Même et surtout quand la tonalité des œuvres est sombre, sans exclure d’ailleurs l’humour (cf la réponse de Garth à Manfred).
À quoi bon lire ? pensent certains. Je pense avoir répondu à la question, que je reformule ainsi : oui, à quoi bon lire des inepties, aussitôt oubliées que lues ? Quand les plus intimes nécessités deviennent pour nous difficiles, écoutons les écrivains et les poètes : «Ennoblissons, mon cœur, l’imagination !» comme écrivait Apollinaire à Lou.
(Marcelle Sauvageot, Laissez-moi (Commentaire) )
C’est curieux comme souvent les lectures, les films, les faits que l’on côtoie dans la vie courante, ce que l’on entend à la radio, les amis que l'on se fait, tissent des liens très étroits avec notre être profond, ce qui me laisse à penser qu’il n’y a pas tant de hasard que ça, que souvent nous tenons entre nos mains la flamme vive de notre unité. Mais ce qui, en plus de l'amitié, rend la vie plus belle, qui nous identifie (j’ai été très content d’entendre un lecteur de mon nouveau livre D’un livre l’autre me dire : «on en apprend plus sur toi dans ce livre que par le précédent», alors que pourtant je parle des écrivains et peu de moi), qui, comme une traînée d’or, nous porte dans les feux du soleil, c’est bien assurément les bons livres.
J’ai lu ces temps-ci deux livres exceptionnels, celui de Marcelle Sauvageot cité en exergue et celui de Robert McLian Wilson, La douleur de Manfred. Tous deux traitent de la douleur de vivre. Dans les deux cas, le personnage principal, la narratrice (l’auteur ?) dans Laissez-moi et le dénommé Manfred, sont gravement malades et en fin de vie, le monde pour eux devient ténèbres.
On pourrait croire qu’en ce moment j’ai plutôt envie de me lancer dans des lectures d’œuvres joyeuses, roboratives, qui me feraient oublier ce que j’ai vécu ces dernières années. Diable, l’oubli se fera tout seul ! D’ailleurs, j’ai toujours été d’un tempérament heureux, et ma capacité d’oubli est incroyable : j’oblitère presque tout de suite les événements tragiques qui me traversent. Sans doute reviennent-ils parfois au galop dans des cauchemars ou même dans des éclairs fugitifs diurnes, mais dans l’ensemble, j’ai toujours pratiqué la résilience sans le savoir, sans connaître même ce mot.
Cependant, j’ai besoin de comprendre aussi, besoin de me comprendre, de savoir comment vivre, comment survivre, et même savoir qui je suis. Ce qui peut paraître étonnant à soixante ans passés : je crois pourtant que le questionnement de Socrate, connais-toi toi-même, dure toute la vie, et qu‘on n‘a pas trop d‘années pour y parvenir. Et là, pas de doute, la littérature peut nous apporter des éléments de réponse, mais pas si elle est lénifiante, ou simplement chargée de divertir (songeons à ces «livres charmants, sans prolongement aucun, sans nuit. Sans silence», dont parlait Marguerite Duras).
J’en reviens toujours à mes interrogations de jeune bibliothécaire, qui me turlupinaient pendant les années 70 : quels livres pour quelle bibliothèque ? Doit-on se contenter d’aligner des best-sellers et de la littérature pré-digérée, ce que demande - hélas - tout un public petit-bourgeois (puisque nous n‘avons pas réussi à attirer le public issu des couches populaires), ou la bibliothèque publique doit-elle avoir une dimension humaine, sociale, éducative, pluraliste, qui permette à des gens comme moi, qui avais peu de livres à la maison, de découvrir les grands écrivains, les seuls à apporter une réponse aux grandes questions de notre existence ? Oui, j’étais reconnaissant aux bibliothèques (et, je l’avoue, à mes amis lecteurs aussi, qui d‘ailleurs continuent à m‘alimenter en nouvelles découvertes) de m’avoir fait connaître Dostoïevski, Kafka, Tchékhov, Kawabata, Shakespeare, Hamsun, Kazantzakis, Goethe parmi bien d’autres phares littéraires, puisqu‘on n‘étudiait que la littérature française au lycée. Peut-on s’en passer ? Il faut croire que oui, puisqu’on ne trouve pas de tels auteurs dans bon nombre de bibliothèques. Refermons la parenthèse, qui pourrait faire l’objet d’un livre entier !

Nos deux héros sont donc en fin de vie, et bien entendu, ils s’interrogent sur la maladie et sur la mort. «Qui sait, il y avait peut-être une trêve avec la maladie ! Elle doit bien de temps en temps se reposer, avoir des dimanches et des jours de fête… Ces jours-là, il doit être possible de vivre comme autrefois», lis-je dans Laissez-moi. La narratrice essaie de comprendre la lettre de rupture de son amoureux, alors qu’elle aurait tant besoin d’être accompagnée par lui jusqu’à la mort. Mais finalement, elle ne lui en veut pas vraiment, elle comprend qu’il n’est qu’un homme, faible, préférant une compagne en meilleur état : «Et pour vous rassurer, vous diriez ce que tout homme bien portant dit des lieux où l‘on souffre : ce n‘est pas si terrible qu‘on le dit.» Oui, en lisant cette phrase, je repensais à Ruth Klüger, et à la difficulté de parler d’Auschwitz : puisqu’on en est revenu, c’est que ça ne devait pas être si terrible, pensaient certains…
Pour Manfred qui, lui, a justement épousé une survivante des camps de la mort, la douleur est une permanence. D’abord, il est juif, et dans l’Angleterre hyper hiérarchisée et raciste (lire attentivement ce savoureux dialogue avec son voisin, l’infirmier noir ; «Saviez-vous que j‘étais juif ?» demanda [Manfred]. Le sourire de Garth grandit jusqu‘à occuper tout son visage. «Saviez-vous que j‘étais noir ?»), il était plutôt au bas de l’échelle. Il a fait la guerre dans l’armée anglaise comme une sorte de zombie, tout étonné de sortir vivant de ce monceau de cadavres : «Les survivants bambochaient et chantaient pour ne rien entendre. La fête était un analgésique, une narcose coupable. L’univers était devenu un ossuaire, un charnier. Nul drapeau, nul idéal de vainqueur ne pouvait être brandi sans tache.» Les débuts de son mariage sont heureux, mais, après la naissance de son fils Martin, il est rongé par les silences d’Emma, et ses démons intérieurs le corrodent : un beau jour, il commence à battre sa femme, qui reste silencieuse, puis continue, de plus en plus sauvagement. Jusqu’au jour où celle-ci, lassée d’être battue, le chasse. Et commence alors pour lui une descente aux enfers, dans une solitude de plus en plus complète, que la maladie contribue à accroître : «Mais il appréhendait la solitude de son appartement - inutile de presser le pas pour retrouver ce lieu désert. Il n‘y avait personne pour remplir les endroits vides de son logement.». Sans parler de la vieillesse, qui concourt à l’isolement. Manfred fait sienne les paroles d’un vieillard qu’il a rencontré : «Vous autres, les jeunes gens, vous êtes pour moi des fantômes, des rêves. Votre monde est irréel. La plupart des gens avec qui j’ai autrefois partagé le monde sont morts. Vous me croyez solitaire et presque défunt. Mais pour moi, c’est vous qui existez à peine.»
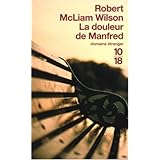
Et je retrouve ici un écho de Marcelle Sauvageot :«Ce temps du passé, quand résonne encore si proche le présent, est triste comme les fins de fête, lorsque les lampes s’éteignent et qu’on reste seul à regarder partir les couples dans les rues sombres.» Oui, quand on cumule tant de discriminations (la judéité pour Manfred, qui pense comme Sartre : «comme toujours lorsqu‘il rencontrait quelque manifestation antisémite, Manfred se sentait soudain un peu plus juif que d‘habitude», la maladie, tuberculose pour Marcelle, cancer pour Manfred, l’abandon par rupture du lien amoureux pour tous les deux, le vieillissement pour Manfred, et l’approche de la mort pour tous les deux), on vit dans un temps différent du temps ordinaire. Et ce que dit McLiam Wilson de Manfred : «Il ne désirait pas vraiment la mort, mais il mourait d’envie d’être débarrassé de la vie», s‘applique aussi à l‘autre livre. Et s’appliquait pour Claire pendant ses derniers mois.
Voilà pourquoi ces livres sont importants, pour moi du moins, et m‘ont permis de mettre des mots sur mon vécu. Ils contribuent, comme tout grand livre, à ne pas dévaluer «l‘étoffe précieuse du temps» dont parle notre auteur. Dans la lueur de la nuit, figée de fatigue comme une bête de somme, quand j’ai ouvert les volets vers sept heures ce matin, j'ai vu la neige tourbillonner, et je sentais davantage d’harmonie en moi grâce à ces lectures, mon âme était moins mélancolique. Et c’est vraiment là la victoire de la littérature, qui nous est à la fois nourriture, vêtement, maison, air pur, espace, reflet de nous-mêmes, puisque nous intégrons, ingérons, assimilons ce que d’autres ont écrit, danse et parfum de l’âme. Même et surtout quand la tonalité des œuvres est sombre, sans exclure d’ailleurs l’humour (cf la réponse de Garth à Manfred).
À quoi bon lire ? pensent certains. Je pense avoir répondu à la question, que je reformule ainsi : oui, à quoi bon lire des inepties, aussitôt oubliées que lues ? Quand les plus intimes nécessités deviennent pour nous difficiles, écoutons les écrivains et les poètes : «Ennoblissons, mon cœur, l’imagination !» comme écrivait Apollinaire à Lou.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire