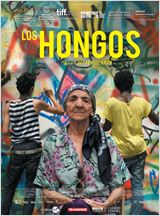1er
mai 1897 :
Finalement,
ce sont les livres qui aident et réconfortent le mieux.
(Virginia
Woolf, Journal
d'adolescence, 1897-1909,
trad. Marie-Ange Dutartre, Stock, 2008)


Toutes
les femmes n'ont pas eu la chance d'avoir un mari attentionné,
attentif, épanouissant, permettant l'éclosion de leur génie :
tel fut Leonard Woolf, et Virginia l'a chaleureusement remercié dans sa
dernière lettre, celle qu'elle lui a adressée juste avant d'aller
se suicider dans la rivière Ouse, en bas de chez eux : "Tu
m'as donné le plus grand bonheur possible",
qui était pour elle d'écrire... Il a religieusement gardé toutes
les archives de Virginia, tous ses manuscrits et lettres inédits.
Nous pouvons donc aujourd'hui lire aussi ses cahiers de jeunesse, publiés
sous le titre Journal
d'adolescence, 1897-1909.
Il est exceptionnel d'assister à la naissance d'un écrivain.
Elle
marche pieds nus pendant les vacances, et elle note : "Lorsque
l'on pose la paume de sa main par terre, on ne sent presque rien ;
en revanche, les pieds, continuellement enveloppés &
emprisonnés, privés de tout contact avec le sol, perçoivent
délicieusement la rugosité de la terre sèche, la douceur & la
fraîcheur de l'herbe, la chaleur des endroits où le soleil donne".
Elle apprécie, comme moi, de se lever tôt et d'assister à
l'éclosion du jour : "Chaque fois que je repense
maintenant à ce qu'est le petit matin, je jure que c'est le moment
le plus beau & le plus rare de la journée – le plus
exceptionnel assurément, à certains égards. On se sent, je dirais,
d'une essence inhabituellement spirituelle, une fois que l'on a
surmonté sont désir physique de sommeil, & le prix de ce combat
– ces heures de clarté supplémentaire – revêt un aspect éthéré
particulier, qui vous honore, en quelque sorte, à vos propres yeux".
Les
cahiers sont très discontinus, car, à plusieurs reprises, elle
souffre pendant des mois de ses horribles migraines et donc l'abandonne. Elle fait le récit de ses
vacances, notamment en Cornouailles, où elle retrouve des souvenirs
d'enfance (qu'elle utilisera dans La
promenade au phare,
un de ses plus beaux romans). Et aussi bien, elle raconte les voyages
qu'elle fait à l'étranger (Italie,
Grèce),
avec ses frères Thoby (son
préféré, celui qui lui fera connaître ses amis de Cambridge, et
qui va décéder prématurément, à la suite d'une typhoïde
contractée en Grèce et mal diagnostiquée : il revivra dans La
chambre de Jacob,
autre roman magnifique)
et Adrian, et
avec sa sœur Vanessa.
 Virginia Stephen, à vingt ans
Virginia Stephen, à vingt ans
portrait par George Charles Beresford
On
la voit aussi essayant de gagner sa vie par l'écriture : elle
place des critiques de livres dans de grands journaux londoniens,
puis des petits essais. Elle, qui n'est jamais allée à l'école
(réservée aux garçons de la famille !), mais qui a eu une
bonne éducation, un accès quasiment libre à la bibliothèque de
son père, Leslie Stephen, grand intellectuel victorien, elle a voulu
apprendre le grec pour lire Aristote, Homère et les tragiques grecs
dans le texte. Elle prévoit ses lectures de vacances : "Cela
me ravit de prévoir ce que je vais lire cet été. Je crois que je
commence par faire une liste dans ma tête des auteurs qui
m'occuperont jusqu'aux environs d'octobre – Shakespeare & la
Bible par exemple. Et puis, le moment venu, je prends finalement un
morceau de papier sur lequel j'inscris Homère, Dante, les discours
de Burke, etc., en ayant déjà l'impression d'avoir commencé à les
lire & d'en avoir tiré un grand profit. Je regroupe ces
différents volumes, les étale sur ma table et j'exulte en pensant
que cette épaisseur de papier va traverser mon cerveau. J'aimerais
être assurée qu'il en gardera quelques traces, mais c'est un doute
que j'écarte loin de moi avant de m'y mettre".
On
la voit enfin observer la comédie
humaine autour d'elle : "Je me demande pourquoi les jeunes gens – les
hommes surtout – ont la curieuse ambition de ressembler aux vieux",
note-t-elle en voyant le groupe de Bloomsbury (les jeunes gens amenés
par Thoby), à la fois très libre et non-conformiste, mais désireux
de se faire une place. Et puis ce type de notation que j'accapare
aussitôt : "Je n'ai jamais pu passer devant une roulotte
de bohémien sans brûler d'envie de me trouver à l'intérieur. Une
maison, sans attaches fixes, qui se déplace dès que le cœur vous
en dit, & parfaitement autonome, voilà assurément le plus
enviable des logis".
Bien
entendu, un tel livre pourra paraître ennuyeux à qui ne s'intéresse
pas au personnage ou à l'écrivain Virginia Woolf. Il m'a fasciné,
je
l'ai dégusté lentement (ça ne peut pas se lire comme un roman !)
de Paris à Poitiers et Bordeaux pendant quinze jours.