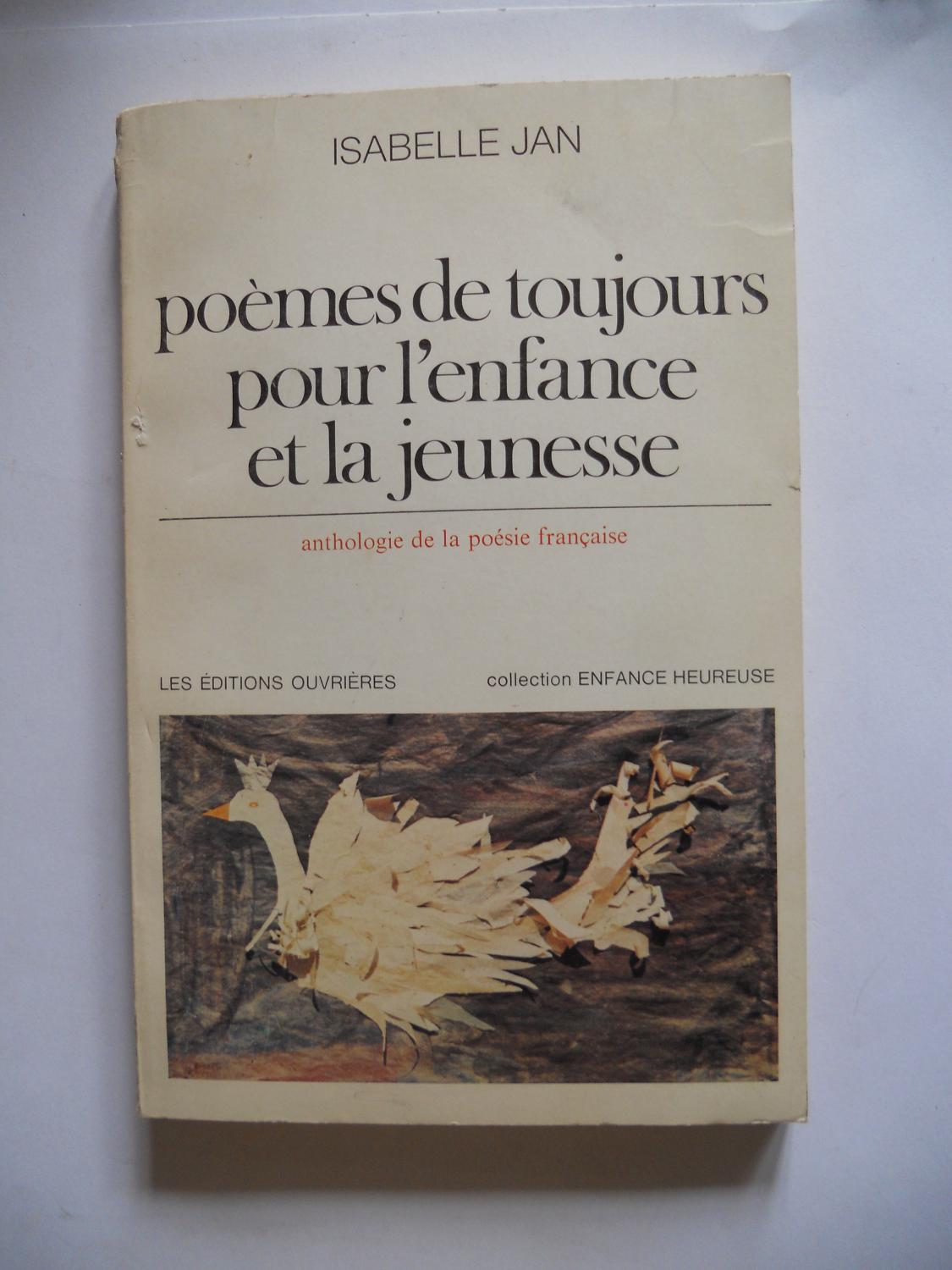Depuis
des dizaines d'années, il sentait s'écouler hors de lui-même,
lentement, continuellement, le fluide vital, la faculté d'exister,
la vie en somme, peut-être aussi la volonté de vivre.
(Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, Le
Guépard)
La
maladie oblige à réfléchir, à faire un retour sur soi, à tenter
sa propre recherche
du temps perdu.
Aidé en cela par les lectures, cela va de soi. Or, je viens de lire
pour la première fois Le
Guépard
de
Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, dont j'avais bien entendu déjà vu plusieurs
fois la version filmée de Visconti (malheureusement jamais sur grand
écran, je l'ai encore ratée à Paris au début de cette année).
J'en suis sorti bouleversé.


Tout
le monde connaît l'intrigue : en 1860, les troupes
garibaldiennes débarquent en Sicile pour chasser les Bourbons du
Royaume de Naples. Une ère nouvelle commence pour le pays. La
vieille aristocratie comprend que ses jours sont comptés, et en
particulier le prince Don Fabrice Salina, dont le blason de famille
est orné d'un léopard dansant (le fameux guépard). Don Fabrice est
sceptique, il ne croit pas en l'avenir, du moins à son avenir, et il
va refuser la proposition qui va lui être faite par la couronne
piémontaise d'être promu sénateur. Il voit son neveu Tancrède,
intelligent et ambitieux, s'enrôler sous la bannière de Garibaldi,
s'amouracher d'Angélique, la jolie fille du maire de Donnafugata, un
commerçant enrichi, et l'épouser, ce qui eut été impensable
quelques années auparavant. Le prince est résigné, son temps est
révolu, place aux jeunes qui sauront se débrouiller dans ce nouveau
monde : "L’œil
de Tancrède le regardait avec l'ironie gentille que le jeunesse
accorde aux personnes âgées. – Ils peuvent se permettre d'être
câlins : ils sont si sûrs qu'au lendemain de nos funérailles,
ils seront libres."
D'ailleurs, il est sûr qu'au fond rien ne change, et l'intelligente
Angélique va se mouler parfaitement à l'aise dans l'aristocratie
avec son Tancrède. Le roman est une suite de tableaux magnifiquement
réussis, qu'il s'agisse d'une partie de chasse du prince avec
l'organiste de l'église, du "cyclone amoureux" entre
Tancrède et Angélique ("C'était
le temps du désir toujours vivant, parce que toujours vaincu, le
temps où s'offraient des lits innombrables que toujours ils
repoussaient, le temps de la frénésie sensuelle qui, matée, se
sublimait durant quelques secondes en renoncements, c'est-à-dire en
véritable amour"),
d'un
bal (celui de la présentation d'Angélique à la haute société),
d'une réunion de famille du jésuite Don Pirrone, confesseur du
prince, ou de l'émouvante mort du prince. Bien sûr, la figure du
prince, "le guépard", domine le livre : survivant de
l'ancienne aristocratie, il a installé un observatoire sur le toit
de son palais et s'y livre à l'observation des étoiles, correspond
avec Arago et l'Académie des sciences de Paris. Mais les personnages secondaires abondent, tous
superbement typés, sa femme, ses filles, ses domestiques et
régisseurs, les nouveaux riches, ses chiens même. Comme le grand roman de Proust (et on
comprend que Visconti ait aussi songé à l'adapter au cinéma), Le
guépard est
l’œuvre d'une vie.
Et
voici où je voulais en venir : je me sens après cette lecture,
un "guépard" moi aussi, assis le cul entre deux chaises,
le passé, que je connais bien et dont je pourrais tirer un roman si
j'en avais le talent, et l'avenir que j'ignore et qui, je l'avoue, ne
m'intéresse pas : c'est l'affaire des jeunes, nourris de
nouvelles technologies et d'un monde nouveau en train de se faire, et
qui se fera sans moi. Par exemple, qu'on ne me demande pas de me
passionner pour la prochaine élection américaine, ainsi que mon
vieil ami de lycée (venu passer deux jours ici) a tenté de m'en
convaincre ! Ni pour les universités d'été des uns ou des
autres : je suis devenu diantrement sceptique ! Je suis
particulièrement effrayé de voir tant de têtes chenues à
l'Assemblée nationale : parbleu, je crois bien qu'il devrait y avoir une limite
d'âge !
"Don
Fabrice pouvait s'échapper sans remords" : voilà, moi
aussi. Et lisez ou relisez ce très grand livre !