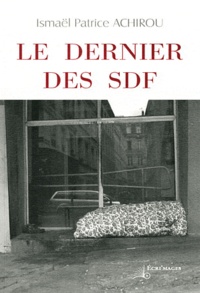Incertitude de savoir si, oui ou non, on existe, si on existe réellement, et de façon permanente.
(Leo Lipski, Piotruś)
Je sens que je vais de nouveau revenir sur un thème qui m'est cher, celui de l'enfermement (j'ai connu celui des internats d'autrefois, dans nos lycées où, dès la sixième, les pensionnaires étaient soumis à un bouclage complet, derrière de hauts murs). J'écrivais encore là-dessus récemment à propos des maisons de retraite, qui malheureusement sont bien des lieux clos, où l'on fait connaissance avec "le silence qui a des pattes, le silence qui a des griffes, le silence dur comme le marbre et qui résiste à tous les ongles" (Stig Dagerman, Mon fils fume une pipe en écume de mer, in Notre plage nocturne), et où l'on se demande "comment faire que l‘individu reste une personne à part entière jusqu‘au bout de sa vie" (Michel Billé, Didier Wartz, La tyrannie du "bien vieillir"). Ceci malgré le bon vouloir des équipes de soins.
Mais il est des lieux encore plus terribles. Le film documentaire de Stéphane Mercurio, À l'ombre de la république, pointe du doigt des territoires que la population en général ne fréquente guère, les prisons (que je connais aussi en partie, en tout cas j'y suis souvent entré) et les hôpitaux psychiatriques (là, terra incognita totalement pour moi). Nous y suivons le travail du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL, voir le site http://www.cglpl.fr/), dont j'avoue à ma grande honte que j'ignorais l'existence. Ce contrôleur, tout nouveau, a été nommé pour six ans en 2008 (une des bonnes décisions de notre président, donc), il est indépendant et irrévocable. Sa mission est d'inspecter, avec l'aide de bénévoles (dont beaucoup sont issus de la magistrature et du secteur social), tous les lieux fermés : prisons, hôpitaux psychiatriques, centres éducatifs fermés (pour jeunes délinquants, centres peu éloignés des anciennes maisons de correction blâmées par Auguste Le Breton dans Les hauts murs), centres de rétention (pour les sans-papiers en attente de renvoi), dépôts de tribunaux, locaux de garde à vue dans les commissariats... Le rôle de ce contrôleur est de voir dans quelle mesure le droit est respecté, la dignité de l'individu sauvegardée, et de constater par des visites l'espace vital, la salubrité des lieux, ainsi que de recueillir des témoignages et des plaintes, s'il y a lieu.
Le film nous montre l'équipe du CGLPL inspectant des prisons (maison d'arrêt de femmes de Versailles, prison centrale de l'île de Ré, prison nouveau modèle de Bourg-en-Bresse, identique à celles de Vivonne et de Mont de Marsan), les locaux d'un commissariat, ainsi que l'hôpital psychiatrique d'Èvreux. S. Mercurio n'a pas eu l'autorisation d'aller filmer en centre de rétention, ce qui en dit long sur le non-droit qui y règne. Bien sûr, on assiste à de nombreux entretiens entre les gens du CGPLP et les détenus, le personnel pénitentiaire, ou les malades et les équipes soignantes. La réalisatrice (oui, malgré son prénom, c'est une femme, paraît-il) ne porte aucun jugement sur les raisons de la présence des individus enfermés. Simplement, elle s'attache à montrer leur vie à l'intérieur, là où l'on est empêché de "regarder le ciel s’en revenir de loin", comme dit le poète (Jean-Marie Gilory, Souffles du large et de la rive).
Le CGLPL pointe du doigt l'arbitraire (les surveillants ont leurs têtes), les injustices, l'exploitation éhontée dans les ateliers (pas besoin d'aller délocaliser en Chine, on peut délocaliser en prison), les privations inadmissibles (un malade de l'hôpital est privé de fromage, de dessert et de café, parce qu'il n'a pas mangé le plat principal, par exemple, ou bien les visites sont interdites aux détenus qui ont été transférés à l'hôpital psy ; des détenus sont privés d'aller à l'école où l'institutrice les attend vainement), l'absurdité des longues peines... À Ré, par exemple, plusieurs détenus savent qu'ils ne sortiront pas, car ce n'est pas la prison qui les adaptera à une éventuelle sortie, quand on a passé vingt ans ou plus en prison : un interviewé y est depuis trente-deux ans, il est entré à dix-huit ans, alors qu'il n'a tué ni violé personne (on comprend qu'il a dû braquer une banque, et on sait qu'on paye plus lourdement quand on s'attaque au sacro-saint argent!). La caméra s'attarde longuement sur les lieux clos, les cellules minuscules, les mitards, les couloirs interminables, les cours (?) de promenade, les chambres de contention pour les psys présumés dangereux et attachés dans leurs lits. "Vivre est bon quand ce n'est pas survivre. La vie réclame quelques moyens. Une pauvre vie a beau être une vie, elle est pauvre. Ce qui lui enlève de la vie", nous dit Bertrand Vergely, dans sa Petite philosophie pour jours tristes. Triste et bien pauvre vie que celle de ces enfermés !
J'ai été pour ma part encore plus bouleversé par l'hôpital psychiatrique. Je croyais pourtant que depuis les travaux de Michel Foucault (qui a écrit sur la psychiatrie Histoire de la folie à l'âge classique, et Surveiller et punir sur les prisons) et de David Cooper (Psychiatrie et anti-psychiatrie), qui avaient enthousiasmé le jeune lecteur que j'étais dans les années 70, les choses avaient un peu évolué. On apprend dans le film qu'à l'hôpital d'Évreux, 30 % des patients sont admis (et complètement enfermés) sans leur consentement, certains sur un simple arrêté municipal, sans certificat médical préalable !!! Évidemment, "nous vivons à une époque où les décisions politiques ne tiennent plus compte des réalités sociétales, mais du caractère médiatisable des événements", comme dit Ismaël Patrice Achirou, dans Le dernier des SDF. Comme tous ces gens-là (malades mentaux, prisonniers) ne sont en rien médiatisables, que la majorité de la population préfère fermer les yeux sur leur existence et laisser croître "la haine aux ongles de nuit" (Aragon, Elsa), on n'est pas prêt d'en entendre parler dans la course présidentielle (ou le match, on ne sait plus) !
L'écrivain Marc Stéphane, qui fut enfermé dans La cité des fous, nous dit qu'on finit par y devenir "subversif ? Je concède. Anarchiste ? Si vous voulez. Non davantage, toutefois, que par exemple, le Jésus des évangiles, Paul de Tarse, Saint-Jean Bouche d'Or, certains pères de l'Église, les saints de la Légende dorée, ou l'auteur regrettablement anonyme de l'Imitation [de Jésus-Christ]. (Essayez un peu de vivre les préceptes de ces gaillards-là, dans votre société qui se prétend chrétienne – et vous verrez comment que l'on criera à la chienlit !)". On va encore me traiter d'anar – et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si je suis allé voir ce film – mais je suis comme le poète québécois Gaston Miron, qui nous susurre dans L'homme rapaillé : "je me fais idéologique (je n'avoue pas, je refuse que CECI soit le normal, soit l'ordre social naturel)".
Je suis comme le héros de Balzac : "Ah ! mon cher, nous accusons trop facilement la misère. Soyons indulgents pour les effets du plus actif des dissolvants sociaux. Là où règne la misère, il n‘existe plus ni pudeur, ni crimes, ni vertus, ni esprit" (La peau de chagrin). Car toutes les personnes vues dans le film sont marquées du sceau de la misère. Les misérables de Victor Hugo sont parmi nous. Et qu'on arrête de nous dire que les classes sociales n'existent plus ! On le sait. "Et toujours une angoisse neuve / nous pose une autre question", chante Aragon dans Elsa. Que peut-on faire, alors ? Blaise Cendrars ne nous aide pas beaucoup quand il écrit : "Dieu, ce qu'il est difficile de venir en aide à un être humain. […] J'aurais voulu lui faire comprendre que rien de ce qu'elle ressentait ne m'était étranger. À quoi bon, c'est l'éternel malentendu, aucun sentiment ne se partage, pas plus la sensation que la sensibilité, la parole qu'un baiser. On n'est pas fait pour vivre en société. On n'a pas de semblable. On est toujours seul" (dans la nouvelle Pompon, in Trop c'est trop). Ni l'Islandais Stefán Máni, dans son roman très sombre Noir océan : "La vie n'est rien d'autre qu'une danse dénuée d'espoir sur un fil tendu où nous finissons tous, tôt ou tard, par perdre l'équilibre avant d'être précipités dans un vide sombre et absolu..."
Je cherche du côté des poètes ou des écrivains un peu mystiques : "Qui ne dit rien et ne fait rien face aux massacres consent, se constitue obliquement complice", nous confie Sylvie Germain, dans Les échos du silence, faisant ainsi chorus avec notre Québécois. L'équipe du CGLPL ne se résout pas au silence : un rapport est chaque année remis au Président de la République. Il doit être lu, car les exactions les plus criantes sont sévèrement sanctionnées, semble-t-il. Peut-être verra-t-on s'estomper peu à peu ce qu'Aragon fustige dans Elsa : "Tout ce qui prend au soir tombant couleur de cruauté". Car il est facile d'être cruel quand on a le pouvoir dans un lieu d'enfermement...